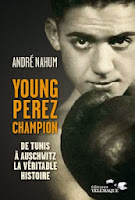Le pèlerinage islamique à La Mecque (Arabie saoudite) ou « hajj constitue un événement religieux, mais aussi social et culturel, rassemblant des croyants d’ethnies, de langues et de provenances différentes ». C'est l'un des cinq piliers de l'islam. Le 29 juillet 2020 a débuté le pèlerinage à La Mecque dans le cadre de la pandémie de coronavirus.
« Les religions » par Sylvie Deraime
Il était plusieurs fois… et Kuehn Malvezzi House of One au 104
Jésus et l’islam » de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur
Lieux saints partagés. Coexistences en Europe et en Méditerranée
L’Empire du sultan. Le monde ottoman dans l’art de la Renaissance
« La fin des Ottomans », par Mathilde Damoisel
« La croix gammée et le turban, la tentation nazie du grand mufti » de Heinrich Billstein
« Alger, la Mecque des révolutionnaires (1962-1974) » par Ben Salama
« Pictures for Peace. La douleur après l’attentat - Hocine Zaourar » par Rémy Burkel
Le Maroc médiéval. Un empire de l’Afrique à l’Espagne
Splendeurs de l’écriture au Maroc. Manuscrits rares et inédits
Le Maroc & l'Europe. Six siècles dans le regard de l’autre
« Le Maghreb sous la croix gammée » de Bill Cran et Karin Davison
« Cheikh Zayed, une légende arabe » par Frédéric Mitterrand
« Emirats, les mirages de la puissance », par Frédéric Compain
L’Arabie saoudite
L'Etat islamique
Interview de Bat Ye’or sur le califat et l’Etat islamique/ISIS
L’Irak, une ex-mosaïque ethnico-religieuse
Les Yézidis ou Yazidis
« Oman, au pays des contes » par Nadja Frenz
« Les pharaons de l’Egypte moderne : Moubarak » par Jihan el Tahri
Soirée Erdogan sur Arte
Soirée sur Arte consacrée à l'Iran
« La révolte du Mahdi. Naissance du Soudan britannique » de Robert Schotter
« Yémen, le chaos et le silence » par François-Xavier Trégan
Soirée Erdogan sur Arte
Soirée sur Arte consacrée à l'Iran
« La révolte du Mahdi. Naissance du Soudan britannique » de Robert Schotter
« Yémen, le chaos et le silence » par François-Xavier Trégan
"500 000 personnes visitent chaque année l’Institut du Monde Arabe. C’est considérable, c’est impressionnant et en même temps ce n’est pas surprenant car depuis des siècles la circulation des biens, des idées et des personnes a lié nos destins, les destins de la France et du Monde Arabe", a déclaré le Président François Hollande lors du vernissage de cette exposition, en présence notamment de dirigeants saoudiens, le 22 avril 2014 à l'IMA.
Des "messages politiques"
 Et le Président François Hollande de poursuivre : "L’arabe a été enseigné, ici à Paris, depuis le 16ème siècle. Les études islamiques se sont très tôt épanouies et il y a même eu la création d’une « Bibliothèque orientale » qui, à partir du 17ème siècle a servi d’encyclopédie pour l’Islam... La France a toujours voulu être une nation ouverte au monde, à toutes les influences, à tous les peuples, à toutes les cultures, à toutes les religions. Cet attrait est encore plus vrai aujourd’hui, par rapport au monde arabe et par rapport à l’Islam, quand tant de nos compatriotes sont unis par leurs origines ou par leurs croyances à l’Afrique du Nord et au Moyen-Orient".
Et le Président François Hollande de poursuivre : "L’arabe a été enseigné, ici à Paris, depuis le 16ème siècle. Les études islamiques se sont très tôt épanouies et il y a même eu la création d’une « Bibliothèque orientale » qui, à partir du 17ème siècle a servi d’encyclopédie pour l’Islam... La France a toujours voulu être une nation ouverte au monde, à toutes les influences, à tous les peuples, à toutes les cultures, à toutes les religions. Cet attrait est encore plus vrai aujourd’hui, par rapport au monde arabe et par rapport à l’Islam, quand tant de nos compatriotes sont unis par leurs origines ou par leurs croyances à l’Afrique du Nord et au Moyen-Orient". "Le pèlerinage à La Mecque appartient aussi à toute l’humanité. C’est vrai que c’est d’abord un acte pieux, un acte religieux... Aujourd’hui, aller à La Mecque n’est plus une aventure, c’est un événement planétaire. La ville – nous avons là aussi quelques preuves de son évolution, de sa transformation – a connu modifications considérables pour adapter les lieux, tout en gardant leur caractère sacré, aux besoins des pèlerins. Pour les autorités saoudiennes, l’organisation du Hajj est une immense responsabilité à laquelle le roi ABDALLAH, Gardien des deux lieux saints, est particulièrement vigilant et attaché. La France contribue, à sa place, à assurer la sécurité des lieux saints. C’est un principe essentiel si l’on veut accueillir près de 3 millions de pèlerins, ce qui est le cas aujourd’hui. Parmi ces 3 millions de pèlerins, il y a aussi les musulmans venus de France. Ils sont chaque année près de 25 000, ce sont les plus nombreux d’Europe. La France est attentive aussi à leurs besoins. Pas depuis ces dernières années, depuis longtemps ! Nous avons retrouvé la trace d’un consulat à Djeddah, dès 1841, pour porter assistance aux pèlerins. Aujourd’hui encore, avec une dimension nouvelle, avec une échelle qui n’a plus rien à voir, la France fait en sorte de pouvoir assurer aux croyants, aux pèlerins venant de notre sol, les meilleures conditions. Le gouvernement a soutenu la signature d’une charte de qualité par les opérateurs agréés du Pèlerinage pour s’en assurer", a dit le Président François Hollande.
"Le pèlerinage à La Mecque appartient aussi à toute l’humanité. C’est vrai que c’est d’abord un acte pieux, un acte religieux... Aujourd’hui, aller à La Mecque n’est plus une aventure, c’est un événement planétaire. La ville – nous avons là aussi quelques preuves de son évolution, de sa transformation – a connu modifications considérables pour adapter les lieux, tout en gardant leur caractère sacré, aux besoins des pèlerins. Pour les autorités saoudiennes, l’organisation du Hajj est une immense responsabilité à laquelle le roi ABDALLAH, Gardien des deux lieux saints, est particulièrement vigilant et attaché. La France contribue, à sa place, à assurer la sécurité des lieux saints. C’est un principe essentiel si l’on veut accueillir près de 3 millions de pèlerins, ce qui est le cas aujourd’hui. Parmi ces 3 millions de pèlerins, il y a aussi les musulmans venus de France. Ils sont chaque année près de 25 000, ce sont les plus nombreux d’Europe. La France est attentive aussi à leurs besoins. Pas depuis ces dernières années, depuis longtemps ! Nous avons retrouvé la trace d’un consulat à Djeddah, dès 1841, pour porter assistance aux pèlerins. Aujourd’hui encore, avec une dimension nouvelle, avec une échelle qui n’a plus rien à voir, la France fait en sorte de pouvoir assurer aux croyants, aux pèlerins venant de notre sol, les meilleures conditions. Le gouvernement a soutenu la signature d’une charte de qualité par les opérateurs agréés du Pèlerinage pour s’en assurer", a dit le Président François Hollande. Sur cette "exceptionnelle exposition", il a estimé : "Beaucoup découvriront – ceux qui ne le connaissent pas, par définition – que la figure d’Abraham est très présente. Ici, c’est le rassemblement de religions monothéistes. Beaucoup comprendront la communion des fidèles, un certain nombre de rites, notamment la lapidation du diable et aussi comment le pèlerinage est à la fois resté immuable et en même temps a considérablement changé, ne serait-ce que par l’ampleur de l’accueil qui est réservé aux pèlerins. La ville de la Mecque se transforme, il y a des travaux considérables qui sont effectués et qui ne s’achèveront que dans plusieurs années. Là aussi, la France y prend sa part. Cette exposition a aussi un message politique qui doit être ici prononcé. Quel est-il ? C’est d’abord la force de la relation entre la France et le monde arabe. Le message, c’est celui de la compréhension : compréhension des cultures, compréhension des civilisations, compréhension des religions. Le message, c’est celui de la tolérance qui est ce qui nous unit, le respect. Ce message, c’est celui de la reconnaissance de religions qui peuvent être différentes et qui néanmoins partagent un certain nombre de valeurs. Ce sont ces principes et ces messages qui permettent de nous unir aujourd’hui mais aussi d’affirmer le caractère sacré des religions et également de dénoncer leur dévoiement. Je veux, ici, souligner les cruautés du fanatisme quand il s’empare de certains individus et mettre en garde ceux qui s’y laissent prendre".
Et d'annoncer le plan du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, "contre les filières djihadistes" : "Aujourd’hui le ministre de l’Intérieur travaille à un plan – qui sera présenté mercredi au Conseil des ministres – afin que notre pays, comme l’Arabie saoudite l’a fait également, prenne toutes les mesures pour dissuader, empêcher, punir ceux ou celles qui seraient tentés d’aller livrer des combats là où ils n’ont pas leur place. La France déploiera tout un arsenal en utilisant toutes les techniques, y compris la cybersécurité, mais aussi les techniques humaines – celles qui consistent tout simplement à parler, à aller chercher dans les familles un certain nombre d’alertes qui nous permettent ensuite d’intervenir. Ce plan n’est pas fait pour empêcher l’acte de foi, mais il est fait pour que la religion ne soit pas utilisée à d’autre fins et notamment la fin la plus abominable qui est le terrorisme".
 Enfin, le Président de la République a rappelé "le lien d’amitié que nous avons avec l’Arabie saoudite, mais au-delà, montrer que l’échange des cultures, le respect des religions, la solidarité des peuples sont de belles missions. Missions qui ont été confiées à l’Institut du Monde arabe, que la France soutient politiquement, humainement, financièrement. Puisqu’ici il y a un certain nombre de représentants de pays ou d’amis qui veulent promouvoir la culture du monde arabe, je lance un appel, celui que Jack Lang n’a pas pu prononcer. Je sais que ce qui nous unit est profond. Je sais que cette exposition est aussi un symbole de ce qu’un pays laïc comme la France est capable de démontrer, que la religion est aussi une culture. Qu’il nous soit permis de dire que nous devons œuvrer au rassemblement, à la solidarité et à la paix. C’est également ce que signifie cette belle exposition dont je ne doute pas du succès".
Enfin, le Président de la République a rappelé "le lien d’amitié que nous avons avec l’Arabie saoudite, mais au-delà, montrer que l’échange des cultures, le respect des religions, la solidarité des peuples sont de belles missions. Missions qui ont été confiées à l’Institut du Monde arabe, que la France soutient politiquement, humainement, financièrement. Puisqu’ici il y a un certain nombre de représentants de pays ou d’amis qui veulent promouvoir la culture du monde arabe, je lance un appel, celui que Jack Lang n’a pas pu prononcer. Je sais que ce qui nous unit est profond. Je sais que cette exposition est aussi un symbole de ce qu’un pays laïc comme la France est capable de démontrer, que la religion est aussi une culture. Qu’il nous soit permis de dire que nous devons œuvrer au rassemblement, à la solidarité et à la paix. C’est également ce que signifie cette belle exposition dont je ne doute pas du succès".Finalement, entre les richissimes et problématiques Qatar et l'Arabie saoudite, la France ne sait lequel privilégier...
 Alors les demandes des parents de Candice Cohen-Ahnine afin de revoir leur-petite-fille Haya née de l'union de cette jeune femme française Juive avec le prince saoudien Sattam al Saud bin Naser bin Abdul Aziz et otage en Arabie saoudite...
Alors les demandes des parents de Candice Cohen-Ahnine afin de revoir leur-petite-fille Haya née de l'union de cette jeune femme française Juive avec le prince saoudien Sattam al Saud bin Naser bin Abdul Aziz et otage en Arabie saoudite...
"Art du pèlerinage"
Hajj, le pèlerinage à La Mecque est une exposition organisée par l’Institut du monde arabe (IMA) et la Bibliothèque nationale du Roi Abdulaziz à Riyad (Arabie Saoudite), avec la participation du British Museum, « sous la direction scientifique des commissaires Omar Saghi, écrivain, scénariste et Fahad Abdulkareem, directeur des affaires culturelles et éducatives de la Bibliothèque nationale du Roi Abdulaziz », avec le soutien exceptionnel de la Fondation d’entreprise Total, Grand Mécène de l’IMA depuis 2011, qui entend « contribuer au partage des cultures ».
Environ « 230 pièces, très souvent inédites en France, en provenance de collections publiques et privées", dont celle de Nasser Khalili, collectionneur britannique Juif d'origine iranienne, "de bibliothèques et de galeries d’art contemporain, d’Afrique, d’Asie et d’Europe » sur « la géographie sacrée dont La Mecque et la Kaaba sont le centre ».
Hajj, le pèlerinage à La Mecque est une exposition organisée par l’Institut du monde arabe (IMA) et la Bibliothèque nationale du Roi Abdulaziz à Riyad (Arabie Saoudite), avec la participation du British Museum, « sous la direction scientifique des commissaires Omar Saghi, écrivain, scénariste et Fahad Abdulkareem, directeur des affaires culturelles et éducatives de la Bibliothèque nationale du Roi Abdulaziz », avec le soutien exceptionnel de la Fondation d’entreprise Total, Grand Mécène de l’IMA depuis 2011, qui entend « contribuer au partage des cultures ».
Environ « 230 pièces, très souvent inédites en France, en provenance de collections publiques et privées", dont celle de Nasser Khalili, collectionneur britannique Juif d'origine iranienne, "de bibliothèques et de galeries d’art contemporain, d’Afrique, d’Asie et d’Europe » sur « la géographie sacrée dont La Mecque et la Kaaba sont le centre ».
Le "plus important prêteur de l’exposition Hajj, le pèlerinage à La Mecque, se trouve être le Professeur Nasser David Khalili grâce auquel l’Institut du monde arabe a pu naguère présenter à son public l’exposition Arts de l’islam (6 octobre 2009-14 mars 2010), exclusivement constituée de pièces issues de sa collection. Cet immense collectionneur a souvent été désigné par différents chefs d’Etats et hommes politiques du monde islamique, comme l’« ambassadeur culturel de l’islam ».
Né dans une famille Juive à Ispahan (Iran), Nasser Khalili a, d’abord, poursuivi ses études aux Etats-Unis, à partir de 1967, avant de s’installer au Royaume-Uni en 1978. Il fait fortune dans l'immobilier.
 Nasser Khalili a constitué "huit collections consacrées à des domaines aussi divers que les émaux, l’art japonais ou encore les textiles scandinaves. Chacune de ses collections constitue dans son secteur la plus importante au monde. Celle qu’il a rassemblée sur les arts du monde islamique, des origines à nos jours, se prolonge d’une autre, consacrée pour sa part, spécifiquement au hajj et aux arts du pèlerinage, laquelle est riche de quelque 1 500 reliques couvrant toute l’histoire du pèlerinage à La Mecque, de l’an 700 à nos jours. Les objets en provenance de cette collection ont permis que puissent être organisées" les expositions Hajj: Journey to the Heart of Islam (26 janvier-15 avril 2012) au British Museum de Londres (Grande-Bretagne) et Longing for Mecca – the pilgrim’s journey (10 septembre 2013-9 mars 2014) au National Museum of Ethnology de Leiden (Pays-Bas).
Nasser Khalili a constitué "huit collections consacrées à des domaines aussi divers que les émaux, l’art japonais ou encore les textiles scandinaves. Chacune de ses collections constitue dans son secteur la plus importante au monde. Celle qu’il a rassemblée sur les arts du monde islamique, des origines à nos jours, se prolonge d’une autre, consacrée pour sa part, spécifiquement au hajj et aux arts du pèlerinage, laquelle est riche de quelque 1 500 reliques couvrant toute l’histoire du pèlerinage à La Mecque, de l’an 700 à nos jours. Les objets en provenance de cette collection ont permis que puissent être organisées" les expositions Hajj: Journey to the Heart of Islam (26 janvier-15 avril 2012) au British Museum de Londres (Grande-Bretagne) et Longing for Mecca – the pilgrim’s journey (10 septembre 2013-9 mars 2014) au National Museum of Ethnology de Leiden (Pays-Bas).
Nasser David Khallili est "le plus grand collectionneur privé d’art islamique au monde », ainsi que l’a souligné Jack Lang lors de l'inauguration, en présence du Président François Hollande. Les œuvres de ses collections ont été montrées aux publics du monde entier dans le cadre d'expositions accueillies par plus de 35 musées.
Nasser Khalili a en outre fondé, en 1989, une chaire d’art et d’archéologie islamiques au sein de l’Institut d’Etudes Orientales et Africaines (School of Oriental and African Studies), de Londres. Grand philanthrope, il a fondé en 1995 "l’Institut Maïmonide dont la vocation est de promouvoir la paix et une meilleure compréhension entre les trois religions révélées. L’engagement du Professeur Nasser D. Khalili en faveur de la paix lui a valu de nombreux honneurs et distinctions. Il a notamment été fait chevalier dans l’Ordre de Saint Sylvestre par le Pape Jean-Paul II, avant d’être élevé au grade de commandeur par Benoît XVI. En 2012, Nasser Khalili a été fait ambassadeur de bonne volonté par l’UNESCO".
Né dans une famille Juive à Ispahan (Iran), Nasser Khalili a, d’abord, poursuivi ses études aux Etats-Unis, à partir de 1967, avant de s’installer au Royaume-Uni en 1978. Il fait fortune dans l'immobilier.
 Nasser Khalili a constitué "huit collections consacrées à des domaines aussi divers que les émaux, l’art japonais ou encore les textiles scandinaves. Chacune de ses collections constitue dans son secteur la plus importante au monde. Celle qu’il a rassemblée sur les arts du monde islamique, des origines à nos jours, se prolonge d’une autre, consacrée pour sa part, spécifiquement au hajj et aux arts du pèlerinage, laquelle est riche de quelque 1 500 reliques couvrant toute l’histoire du pèlerinage à La Mecque, de l’an 700 à nos jours. Les objets en provenance de cette collection ont permis que puissent être organisées" les expositions Hajj: Journey to the Heart of Islam (26 janvier-15 avril 2012) au British Museum de Londres (Grande-Bretagne) et Longing for Mecca – the pilgrim’s journey (10 septembre 2013-9 mars 2014) au National Museum of Ethnology de Leiden (Pays-Bas).
Nasser Khalili a constitué "huit collections consacrées à des domaines aussi divers que les émaux, l’art japonais ou encore les textiles scandinaves. Chacune de ses collections constitue dans son secteur la plus importante au monde. Celle qu’il a rassemblée sur les arts du monde islamique, des origines à nos jours, se prolonge d’une autre, consacrée pour sa part, spécifiquement au hajj et aux arts du pèlerinage, laquelle est riche de quelque 1 500 reliques couvrant toute l’histoire du pèlerinage à La Mecque, de l’an 700 à nos jours. Les objets en provenance de cette collection ont permis que puissent être organisées" les expositions Hajj: Journey to the Heart of Islam (26 janvier-15 avril 2012) au British Museum de Londres (Grande-Bretagne) et Longing for Mecca – the pilgrim’s journey (10 septembre 2013-9 mars 2014) au National Museum of Ethnology de Leiden (Pays-Bas).Nasser David Khallili est "le plus grand collectionneur privé d’art islamique au monde », ainsi que l’a souligné Jack Lang lors de l'inauguration, en présence du Président François Hollande. Les œuvres de ses collections ont été montrées aux publics du monde entier dans le cadre d'expositions accueillies par plus de 35 musées.
Nasser Khalili a en outre fondé, en 1989, une chaire d’art et d’archéologie islamiques au sein de l’Institut d’Etudes Orientales et Africaines (School of Oriental and African Studies), de Londres. Grand philanthrope, il a fondé en 1995 "l’Institut Maïmonide dont la vocation est de promouvoir la paix et une meilleure compréhension entre les trois religions révélées. L’engagement du Professeur Nasser D. Khalili en faveur de la paix lui a valu de nombreux honneurs et distinctions. Il a notamment été fait chevalier dans l’Ordre de Saint Sylvestre par le Pape Jean-Paul II, avant d’être élevé au grade de commandeur par Benoît XVI. En 2012, Nasser Khalili a été fait ambassadeur de bonne volonté par l’UNESCO".
Exposition "saoudiennement correcte"
C’est une exposition bilingue français/arabe quasi-exhaustive, paradoxale et un vecteur de communication pour l’Arabie saoudite.
Quasi-exhaustive car elle présente « le pèlerinage à la Mecque dans ses diverses dimensions et à travers leur évolution historique. Expérience mystique individuelle, de méditation religieuse, source d’inspiration artistique et d’échanges transculturels, ces multiples facettes du pèlerinage sont présentées au public à travers des objets d’art médiéval, manuscrits et enluminures, tissus d’apparats et offrandes ».
Une exposition intéressante par ce qu’elle occulte et ce qu’elle révèle, souvent involontairement, sur le royaume wahhabite et sa vision littérale rigoureuse de l’islam.
Une exposition intéressante par ce qu’elle occulte et ce qu’elle révèle, souvent involontairement, sur le royaume wahhabite et sa vision littérale rigoureuse de l’islam.
Plus cette exposition souligne l’importance de La Mecque en islam, plus elle révèle involontairement le quasi désintérêt des musulmans pour Jérusalem qui n’apparaît que dans un des dessins de mosquées vues par un pèlerin et même pas dans la carte de quatre voies maritimes et terrestres du hajj à partir de Paris et Marseille, en France. Classiques voies du hajjj : les routes irakienne, d'Afrique sub-saharienne, et d'Afrique du nord. Seule autre ville sainte en islam évoquée dans un espace réduit en fin de parcours : Médine. De plus, le roi Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud du royaume d'Arabie saoudite est appelé « serviteur des deux saintes mosquées », et non des "trois mosquées"...
Lors du vernissage presse, étaient donnés un catalogue bilingue français/arabe ainsi qu’un assortiment de photographies en couleurs et sur papier glacé « saoudiennement corrects », c’est-à-dire occultant la polémique non pas sur la nécessité des travaux urbanistiques à Médine et à La Mecque afin d’accueillir un nombre croissant de pèlerins, mais sur la nature de ces travaux grandioses susceptible selon le site Oumma.com de transformer La Mecque en "Las Vegas du "royaume wahhabite". Le site Oumma.com s'indigne dès le 17 février 2012 : "La maison du prophète Mohamed et de sa femme Khadija a été démolie pour faire place à des toilettes publiques ! Selon Irfan Ahmed Al-Alawi, qui est le Président de la Fondation du patrimoine islamique, dont l'objectif est de sauvegarder les lieux saints, il resterait seulement moins de vingt édifices historiques remontant à l'époque du Prophète. Parmi ces destructions, la maison d'Abou Bakr (premier Calife de l'islam) a été remplacée par l' Hôtel Hilton. Alors qu'un palais a été édifié sur la mosquée historique d'Abou Qubais. Selon Ali Al-Ahmad, le directeur de l'Institut du Golfe à Washington, 95% des anciens bâtiments de la Mecque ont été démolis au cours des vingt dernières années pour être remplacés par des buildings de plus en plus hauts". Et Oumma de préciser dans son article La destruction planifiée du berceau du Prophète (25 février 2014) : « Qui aurait pu imaginer, même dans les plus noires prédictions, que derrière les gardiens du temple de la monarchie saoudienne se dissimuleraient les fossoyeurs de la richesse du patrimoine islamique, faisant bien peu de cas des vestiges irremplaçables reçus en héritage pour assouvir leur démesure urbanistique ? Sous le règne rigoriste des grands bâtisseurs, le rouleau compresseur de la démolition n’est jamais bien loin, près de 95% du précieux legs historique et archéologique de La Mecque et de Médine (des monuments vieux de 1 000 ans) ayant été ainsi broyé en l’espace de deux petites décennies ». Que font l'UNESCO, la Ligue arabe et l'organisation de la coopération islamique (OCI) ? Quand on songe aux cris d'orfraie des Palestiniens, et du monde arabe en général, quand l'Etat d'Israël avait entamé en 1996 des travaux d'agrandissement d'un tunnel près du mont du Temple afin de favoriser l'accès des touristes... Pourquoi cette omission de la controverse par les commissaires de l'exposition ? Espoir de redorer l’image du royaume wahhabite, dont la conception rigoriste de l’islam est contestée par des musulmans et dont le soutien à des mouvements terroristes islamistes inquiète ? Souci de réislamiser à la saoudienne les musulmans français ? Volonté de maintenir sa place dans le monde musulman, malgré les assauts chiites soutenus par l'Iran et la rivalité avec la Turquie ?
Un « microcosme universel »
Le hajj ou « pèlerinage à la Mecque est l’un des cinq piliers de l’islam – avec la profession de foi (chahâda), la prière, le jeûne du mois de ramadan et l’aumône (zakât) ». Obligation pour le croyant qui a les moyens physiques et matériels de l’effectuer, il doit s’accomplir « à une date précise du mois de dhu al-hijja du calendrier islamique », à la différence « de la umra (petit pèlerinage) ».
L'exposition évoque certains dangers qui menacent les pèlerins, notamment le risque sanitaire - une lettre du 18 avril 1886 du Dr Adrien Proust, médecin hygiéniste, et père de l'écrivain Marcel Proust -, mais peu la bousculade meurtrière. Le 2 octobre 2014, a débuté le Hajj, pèlerinage à La Mecque (Arabie saoudite) qui devrait attirer plus d'un million de musulmans. Les autorités saoudiennes ont adopté des mesures sanitaires face aux menaces du virus Ebola et du coronavirus ou syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS).
L'exposition évoque certains dangers qui menacent les pèlerins, notamment le risque sanitaire - une lettre du 18 avril 1886 du Dr Adrien Proust, médecin hygiéniste, et père de l'écrivain Marcel Proust -, mais peu la bousculade meurtrière. Le 2 octobre 2014, a débuté le Hajj, pèlerinage à La Mecque (Arabie saoudite) qui devrait attirer plus d'un million de musulmans. Les autorités saoudiennes ont adopté des mesures sanitaires face aux menaces du virus Ebola et du coronavirus ou syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS).
Le « pèlerinage a des racines qui remontent à la période antéislamique. Depuis l’instauration de l’islam, c’est-à-dire depuis bientôt quinze siècles, le hajj constitue un événement religieux, mais aussi social et culturel, rassemblant des croyants d’ethnies, de langues et de provenances différentes. Au cours de la décennie écoulée, ce sont ainsi plus de trois millions de pèlerins qui, chaque année, ont accompli le hajj. Théologiens, lettrés, artistes, commerçants, politiques ou simples croyants, font de La Mecque, pendant cinq à six jours, un microcosme universel ». Une union à nuancer : un panneau en début d’exposition indique deux voies : l'une pour les seuls musulmans ("Muslims Only"), l'autre pour les non-musulmans ("For non Muslims"). Sans que nul n’ait manifesté la moindre indignation pour cette discrimination religieuse. Par ailleurs, "les non-Musulmans sont interdits de résidence" à La Mecque. Ce qu'omettent de mentionner l'exposition et la propagande arabe diffamant l'Etat d'Israël en alléguant à tort qu'il pratiquerait l'apartheid.
Des « palais royaux aux plus humbles maisons, en passant par les appartements des villes et des cités, pas une demeure musulmane qui ne contienne un objet exprimant ce désir de La Mecque... Miniatures et gravures naïves, calligraphies savantes expriment de la sorte la centralité de la ville sainte, son ubiquité, dans tous les styles de toutes les cultures islamiques ».
 Parallèlement, « la ville de La Mecque constitue depuis des siècles et des siècles le réceptacle unique d’offrandes et de cadeaux somptueux – en provenance de toutes les grandes villes de l’islam, Damas ou Le Caire, Istanbul ou Ispahan, et de plus loin encore… –, textiles brodés d’or, stèles commémoratives, chandeliers et tapis, envoyés en hommage à l’occasion du pèlerinage ».
Parallèlement, « la ville de La Mecque constitue depuis des siècles et des siècles le réceptacle unique d’offrandes et de cadeaux somptueux – en provenance de toutes les grandes villes de l’islam, Damas ou Le Caire, Istanbul ou Ispahan, et de plus loin encore… –, textiles brodés d’or, stèles commémoratives, chandeliers et tapis, envoyés en hommage à l’occasion du pèlerinage ».
Aux regards d’artistes sur le hajj et d’architectes sur l’aménagement de La Mecque, s’ajoute le regard occidental de « peintres orientalistes, voyageurs et chroniqueurs » qui « se sont interrogés sur cet événement central de l’islam, croisant des thèmes communs aux deux civilisations : universalisme, figure d’Abraham, rapport à l’autre ». L’exposition vise à faire « découvrir ces rites immuables découlant de l’héritage d’Abraham, qui sont suivi scrupuleusement depuis l’année 632, année du pèlerinage de Mahomet ». Pour l'illustrer : le tableau Le sacrifice d'Isaac par Abraham de Rubens illustrant la "tradition judéo-chrétienne", alors que la "tradition musulmane" substitue Ismaël au fils de Sarah. En outre, Abraham n’est pas une figure commune à la Bible et au Coran : Abraham est un patriarche biblique, alors qu’Ibrahim al-Khalil est un prophète dans l’islam. Entretenir cette confusion est d’autant plus inquiétant que sept dates de visite étaient « réservées dans le cadre de la mission « Vivre ensemble » du ministère de la Culture et de la Communication » et que des dirigeants communautaires promeuvent la visite de l’IMA aux élèves d’écoles Juives françaises.
 Cette exposition vise à décrire « l’histoire du hajj ainsi que celle de l’ensemble des rites qui le compose pour donner à comprendre ce que représente la dévotion intemporelle, personnelle et collective, extatique et esthétique, qu’expérimente, à l’occasion du pèlerinage, chaque croyant au sein de la communauté des musulmans, la Oumma. Le parcours de l’exposition propose de suivre les pas de ces pèlerins au cours de leur voyage, du Moyen-âge à nos jours, jusqu’à La Mecque et de les accompagner pendant ces cinq jours sacrés du mois de dhu al-hijja au cours des rites qui composent le hajj : circumambulation autour de la Kaaba (littéralement, le « cube »), course entre Safa et Marwah, station à Arafa, lapidation du diable, sacrifice… » Autre omission majeure de l'exposition : les musulmans n'ont pas toujours prié cinq fois par jour en direction de la ka'ba, "construction cubique, située au cœur du haram (sanctuaire)" de La Mecque, et "attribuée au prophète Abraham et à son fils Ismaël, accomplissant une volonté de Dieu". "Quand Mahomet a cherché à convertir les Juifs en l'an 620 après J.C., il adopta quelques pratiques de style juif - un jeûne semblable à Yom Kippour, un lieu de culte ressemblant à une synagogue, des restrictions alimentaires rappelant la casherout, ainsi que des prières orientées vers Jérusalem. Mais, lorsque la plupart des Juifs refusèrent de se convertir, il changea la direction de la prière pour la Mecque. C'est ainsi que Jérusalem perdit de son importance pour les musulmans" (Daniel Pipes).
Cette exposition vise à décrire « l’histoire du hajj ainsi que celle de l’ensemble des rites qui le compose pour donner à comprendre ce que représente la dévotion intemporelle, personnelle et collective, extatique et esthétique, qu’expérimente, à l’occasion du pèlerinage, chaque croyant au sein de la communauté des musulmans, la Oumma. Le parcours de l’exposition propose de suivre les pas de ces pèlerins au cours de leur voyage, du Moyen-âge à nos jours, jusqu’à La Mecque et de les accompagner pendant ces cinq jours sacrés du mois de dhu al-hijja au cours des rites qui composent le hajj : circumambulation autour de la Kaaba (littéralement, le « cube »), course entre Safa et Marwah, station à Arafa, lapidation du diable, sacrifice… » Autre omission majeure de l'exposition : les musulmans n'ont pas toujours prié cinq fois par jour en direction de la ka'ba, "construction cubique, située au cœur du haram (sanctuaire)" de La Mecque, et "attribuée au prophète Abraham et à son fils Ismaël, accomplissant une volonté de Dieu". "Quand Mahomet a cherché à convertir les Juifs en l'an 620 après J.C., il adopta quelques pratiques de style juif - un jeûne semblable à Yom Kippour, un lieu de culte ressemblant à une synagogue, des restrictions alimentaires rappelant la casherout, ainsi que des prières orientées vers Jérusalem. Mais, lorsque la plupart des Juifs refusèrent de se convertir, il changea la direction de la prière pour la Mecque. C'est ainsi que Jérusalem perdit de son importance pour les musulmans" (Daniel Pipes).
Aux témoignages de pèlerins, les visiteurs peuvent ajouter les leurs en les enregistrant dans une « cabine audio-photomaton ». Ces souvenirs oraux sont complétés par des « souvenirs matériels (cadeaux, certificats de pèlerinages…) déposés par des pèlerins ».
Il est curieux qu'aucun des médias ayant recensé cette exposition n'ait relevé cette ségrégation entre "musulmans" et "non-musulmans", la destruction du patrimoine islamique certes niée par l'Arabie saoudite, cette occultation des liens anciens entre l'islam et le judaïsme, etc.
Le 2 octobre 2014, a débuté le Hajj, pèlerinage à La Mecque (Arabie saoudite) qui devrait attirer plus d'un million de musulmans. Les autorités saoudiennes ont adopté des mesures sanitaires face aux menaces du virus Ebola et du coronavirus ou syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS).
Le 24 septembre 2015, plus de 769 personnes sont mortes et 863 ont été blessées à Mina, près de La Mecque, lorsque deux foules se sont heurtées en venant de directions opposées. Environ deux millions de pèlerins sont réunis pour ce pèlerinage. Au "premier jour de la fête de l’Aïd el-Kébir, les pèlerins avaient commencé le rituel de la lapidation de Satan, dans la vallée de Mina, dans l’ouest de l’Arabie saoudite. Ce rituel consiste à jeter sept pierres le premier jour de l’Aïd el-Kébir sur une grande stèle représentant Satan, et 21 pierres le lendemain ou le surlendemain sur trois stèles – grande, moyenne, petite. La rue 204, où le drame s’est produit, est l’une des deux principales artères menant de Mina à Jamarat où le Diable est symboliquement lapidé par les pèlerins. Sur les sept accidents majeurs ayant endeuillé le pèlerinage depuis 1990, six ont eu lieu lors de ce rituel, le dernier remontant à janvier 2006 quand 364 pèlerins ont péri dans une bousculade à Min"a.
Le 10 septembre 2016, environ 1,5 million de fidèles venus du monde entier ont débuté le pèlerinage à La Mecque (Arabie saoudite).
Des "dizaines de milliers d’Iraniens seront eux privés de pèlerinage cette année, et ce pour la première fois depuis près de trois décennies. Sur les quelque 60 000 qui s’étaient rendus en 2015 à La Mecque, plus de 460 avaient péri dans la bousculade, provoquant la colère de Téhéran, dont les relations étaient déjà très tendues avec Ryad, notamment au sujet des conflits en Syrie et au Yémen. Après ce drame, et en dépit de négociations, les deux puissances régionales rivales ne sont pas parvenues à trouver un accord pour l’envoi des Iraniens au pèlerinage, échangeant cette semaine des invectives qui ont atteint un niveau inédit. Le guide suprême de l’Iran chiite, Ali Khamenei, a estimé que la famille royale saoudienne «ne mérite pas de gérer les lieux saints» de l’islam, alors que le grand mufti de l’Arabie sunnite, Abdel Aziz ben al-Cheikh, a lancé que les Iraniens n’étaient «pas des musulmans». L’Arabie saoudite «ne pense même pas aux mesures de sécurité» pour le pèlerinage, a affirmé Saïd Ohadi, chef de l’organisation iranienne du hajj. Vendredi, des milliers d’Iraniens ont défilé à Téhéran sous des pancartes proclamant qu’ils ne «pardonneraient jamais» à l’Arabie saoudite leur exclusion du hajj".
En 2017, le pèlerinage s'est déroulé du 30 août au 4 septembre 2017.
Le 19 août 2018, plus de deux millions de musulmans, mais pas du Qatar, ont initié ce pèlerinage : "Les plus gros contingents de pèlerins viennent d'Égypte, d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh et du Soudan". "Le jeune prince héritier Mohammed Ben Salman, fils du roi et inspirateur des réformes, a clamé la volonté de son pays de «renouer avec un islam modéré et tolérant», tout en multipliant les arrestations dans les milieux dissidents, y compris parmi les défenseurs des droits de l'Homme et les religieux critiques. Le pèlerinage intervient en outre en pleine guerre au Yémen où l'Arabie saoudite intervient contre des rebelles soutenus par l'Iran, le grand rival régional de Riyad."
"Le siège de La Mecque"
 Arte diffusa le 21 août 2018 à 22 h 45 "Le siège de La Mecque" ("Mekka 1979 - Urknall des Terrors?", "The Siege of Mecca"), documentaire réalisé par Dirk van den Berg. "En 1979, le premier jour du hadj, un commando de 400 extrémistes religieux prend d’assaut la Grande Mosquée de La Mecque, retenant en otages des milliers de pèlerins. Pendant plus de deux semaines, ce siège ébranle l’Arabie Saoudite. Ce film dévoile l’un des secrets les mieux gardés de l’histoire contemporaine, événement fondateur du terrorisme fondamentaliste aussi méconnu que stupéfiant".
Arte diffusa le 21 août 2018 à 22 h 45 "Le siège de La Mecque" ("Mekka 1979 - Urknall des Terrors?", "The Siege of Mecca"), documentaire réalisé par Dirk van den Berg. "En 1979, le premier jour du hadj, un commando de 400 extrémistes religieux prend d’assaut la Grande Mosquée de La Mecque, retenant en otages des milliers de pèlerins. Pendant plus de deux semaines, ce siège ébranle l’Arabie Saoudite. Ce film dévoile l’un des secrets les mieux gardés de l’histoire contemporaine, événement fondateur du terrorisme fondamentaliste aussi méconnu que stupéfiant".
"Avec certains de ses témoins clés, retour sur l'insurrection occultée qui a ciblé en 1979 la Grande Mosquée de La Mecque et sur sa répression sanglante, menée avec le soutien secret de la France. Dirk van den Berg livre un exceptionnel récit de l'intérieur, tirant un à un les fils historiques, politiques et géostratégiques de cet événement spectaculaire et oublié."
 "Le 20 novembre 1979, à l'aube, un commando de plusieurs centaines d'hommes lourdement armés, accompagnés de femmes et d'enfants, prend possession de la Grande Mosquée de La Mecque et transforme le sanctuaire le plus sacré de l'islam en une forteresse. À sa tête, un Saoudien, Juhayman al-Otaibi, prédicateur issu d'une tribu bédouine marginalisée, qui exige l'abdication de la famille royale, l'expulsion de tous les étrangers impies et le retour du pays à un islam pur. Des milliers de pèlerins prennent la fuite, mais plusieurs centaines d'autres sont piégés à l'intérieur, durant un siège qui va durer quinze jours. La famille régnante commence par imposer un secret absolu puis, la situation s'éternisant, en appelle à ses alliés occidentaux."
"Le 20 novembre 1979, à l'aube, un commando de plusieurs centaines d'hommes lourdement armés, accompagnés de femmes et d'enfants, prend possession de la Grande Mosquée de La Mecque et transforme le sanctuaire le plus sacré de l'islam en une forteresse. À sa tête, un Saoudien, Juhayman al-Otaibi, prédicateur issu d'une tribu bédouine marginalisée, qui exige l'abdication de la famille royale, l'expulsion de tous les étrangers impies et le retour du pays à un islam pur. Des milliers de pèlerins prennent la fuite, mais plusieurs centaines d'autres sont piégés à l'intérieur, durant un siège qui va durer quinze jours. La famille régnante commence par imposer un secret absolu puis, la situation s'éternisant, en appelle à ses alliés occidentaux."
 "C'est finalement le GIGN français qui aidera en secret l'armée saoudienne à combattre les insurgés, notamment en lui fournissant plus de 300 kilos de gaz lacrymogène. Au total, le bilan des combats au sein de la Grande Mosquée s'élèverait à des milliers de morts, même si le régime saoudien en reconnaît moins de trois cents. Après l'exécution sans procès des rebelles, il va s'efforcer de faire oublier au pays et au reste du monde cet épisode sanglant, tout en intensifiant la répression de toute forme d'opposition."
"C'est finalement le GIGN français qui aidera en secret l'armée saoudienne à combattre les insurgés, notamment en lui fournissant plus de 300 kilos de gaz lacrymogène. Au total, le bilan des combats au sein de la Grande Mosquée s'élèverait à des milliers de morts, même si le régime saoudien en reconnaît moins de trois cents. Après l'exécution sans procès des rebelles, il va s'efforcer de faire oublier au pays et au reste du monde cet épisode sanglant, tout en intensifiant la répression de toute forme d'opposition."
 "L'ex-chef des services secrets saoudiens Turki al-Fayçal, membre de la famille royale, le journaliste Khaled al-Maeena, le fils du général qui a dirigé l'assaut des forces saoudiennes (lequel offre au réalisateur les vidéos des combats qu'il cherchait depuis cinq ans), d'anciens frères d'armes de Juhayman, un très influent prédicateur djihadiste basé en Jordanie, Abou Mohammad al-Maqdisi, l'ancien attaché militaire américain à Djedda, Mark Hambley, les ex-GIGN Christian Prouteau et Paul Barril, les chercheurs Madawi al-Rasheed et Pascal Ménoret… : grâce à ces témoins et à leurs archives personnelles, Dirk van den Berg livre un exceptionnel récit de l'intérieur, tirant un à un les fils historiques, politiques et géostratégiques de cet événement spectaculaire et oublié. Il révèle ainsi un pan d'une réalité complexe, celle d'un pays fermé d'ordinaire aux regards extérieurs."
"L'ex-chef des services secrets saoudiens Turki al-Fayçal, membre de la famille royale, le journaliste Khaled al-Maeena, le fils du général qui a dirigé l'assaut des forces saoudiennes (lequel offre au réalisateur les vidéos des combats qu'il cherchait depuis cinq ans), d'anciens frères d'armes de Juhayman, un très influent prédicateur djihadiste basé en Jordanie, Abou Mohammad al-Maqdisi, l'ancien attaché militaire américain à Djedda, Mark Hambley, les ex-GIGN Christian Prouteau et Paul Barril, les chercheurs Madawi al-Rasheed et Pascal Ménoret… : grâce à ces témoins et à leurs archives personnelles, Dirk van den Berg livre un exceptionnel récit de l'intérieur, tirant un à un les fils historiques, politiques et géostratégiques de cet événement spectaculaire et oublié. Il révèle ainsi un pan d'une réalité complexe, celle d'un pays fermé d'ordinaire aux regards extérieurs."
On ne comprend pas pourquoi le Conseil régional d'Ile-de-France a subventionné ce documentaire ainsi présenté : "Le 20 novembre 1979, lors du pèlerinage annuel du Hadj, des fondamentalistes saoudiens, dirigé par Juhayman Al-Utaiby, prennent d'assaut la Grande Mosquée de la Mecque, le lieu le plus saint de l'Islam. Ils demandent l'abdication de la famille royale saoudienne, l'expulsion des non-musulmans et le retour d'un Islam intransigeant wahhabite. Commence un siège de 18 jours qui fera près de 5000 morts. Le GIGN obtiendra finalement la réédition du commando. Cet événement est le premier acte d'un mouvement qui donnera naissance à Al Qaïda et Daesh". "Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants". Le montant de la subvention maximum s'élève à 53 000 €. Cela fait cher le coût du stagiaire ou de l'alternant.
Coronavirus
Le 29 juillet 2020 a débuté le pèlerinage à La Mecque dans le cadre de la pandémie de coronavirus. Au 9 juin 2020, "on recensait un total de 105 283 personnes infectées, 746 décès et 74 524 guérisons dans le royaume". Au 29 juillet 2020, le royaume "a enregistré environ 270 000 cas d'infection au nouveau coronavirus, soit l'un des taux les plus élevés du Moyen-Orient".
 "Au lieu de voir défiler 2,5 millions de fidèles, comme l’année dernière, la cité la plus sainte du monde musulman ne devrait accueillir que quelques milliers de croyants, 10 000 au maximum. Une affluence minimale, quasi-symbolique, qui constitue une première dans l’histoire du royaume saoudien, fondé en 1932.
"Au lieu de voir défiler 2,5 millions de fidèles, comme l’année dernière, la cité la plus sainte du monde musulman ne devrait accueillir que quelques milliers de croyants, 10 000 au maximum. Une affluence minimale, quasi-symbolique, qui constitue une première dans l’histoire du royaume saoudien, fondé en 1932.
 "Les autorités saoudiennes ont décidé de maintenir la fermeture de La Mecque aux pèlerins étrangers. Cette décision avait été prise fin février, à l’orée de la crise sanitaire. Alors même qu’aucun cas d’infection par le Covid-19 n’avait été enregistré dans le pays, Riyad avait suspendu la délivrance de visa pour l’omra, le petit pèlerinage, qui peut être effectué tout au long de l’année."
"Les autorités saoudiennes ont décidé de maintenir la fermeture de La Mecque aux pèlerins étrangers. Cette décision avait été prise fin février, à l’orée de la crise sanitaire. Alors même qu’aucun cas d’infection par le Covid-19 n’avait été enregistré dans le pays, Riyad avait suspendu la délivrance de visa pour l’omra, le petit pèlerinage, qui peut être effectué tout au long de l’année."
"L’autorisation de participer au grand pèlerinage, qui se tient traditionnellement à l’approche de la fête de l’Aïd-el-Kébir, la plus importante date du calendrier musulman, n’a donc été délivrée qu’à une poignée d’habitants du royaume ; 30 % d’entre eux sont des Saoudiens, professionnels de la santé et membres de l’armée, qui ont attrapé le Covid-19 dans le cadre des efforts déployés par l’Etat pour lutter contre cette maladie, ont guéri et se voient ainsi récompensés pour leur dévouement. Les 70 % restant sont des résidents étrangers, choisis par tirage au sort."
"Le siège de La Mecque" documentaire réalisé par Dirk van den Berg.
Allemagne, France, Outremer Film, K2 Productions, INA, PROCIREP - Société des Producteurs, Conseil régional d'Ile-de-France, 2015, 52 min
Il est curieux qu'aucun des médias ayant recensé cette exposition n'ait relevé cette ségrégation entre "musulmans" et "non-musulmans", la destruction du patrimoine islamique certes niée par l'Arabie saoudite, cette occultation des liens anciens entre l'islam et le judaïsme, etc.
Le 2 octobre 2014, a débuté le Hajj, pèlerinage à La Mecque (Arabie saoudite) qui devrait attirer plus d'un million de musulmans. Les autorités saoudiennes ont adopté des mesures sanitaires face aux menaces du virus Ebola et du coronavirus ou syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS).
Le 24 septembre 2015, plus de 769 personnes sont mortes et 863 ont été blessées à Mina, près de La Mecque, lorsque deux foules se sont heurtées en venant de directions opposées. Environ deux millions de pèlerins sont réunis pour ce pèlerinage. Au "premier jour de la fête de l’Aïd el-Kébir, les pèlerins avaient commencé le rituel de la lapidation de Satan, dans la vallée de Mina, dans l’ouest de l’Arabie saoudite. Ce rituel consiste à jeter sept pierres le premier jour de l’Aïd el-Kébir sur une grande stèle représentant Satan, et 21 pierres le lendemain ou le surlendemain sur trois stèles – grande, moyenne, petite. La rue 204, où le drame s’est produit, est l’une des deux principales artères menant de Mina à Jamarat où le Diable est symboliquement lapidé par les pèlerins. Sur les sept accidents majeurs ayant endeuillé le pèlerinage depuis 1990, six ont eu lieu lors de ce rituel, le dernier remontant à janvier 2006 quand 364 pèlerins ont péri dans une bousculade à Min"a.
Le 10 septembre 2016, environ 1,5 million de fidèles venus du monde entier ont débuté le pèlerinage à La Mecque (Arabie saoudite).
Des "dizaines de milliers d’Iraniens seront eux privés de pèlerinage cette année, et ce pour la première fois depuis près de trois décennies. Sur les quelque 60 000 qui s’étaient rendus en 2015 à La Mecque, plus de 460 avaient péri dans la bousculade, provoquant la colère de Téhéran, dont les relations étaient déjà très tendues avec Ryad, notamment au sujet des conflits en Syrie et au Yémen. Après ce drame, et en dépit de négociations, les deux puissances régionales rivales ne sont pas parvenues à trouver un accord pour l’envoi des Iraniens au pèlerinage, échangeant cette semaine des invectives qui ont atteint un niveau inédit. Le guide suprême de l’Iran chiite, Ali Khamenei, a estimé que la famille royale saoudienne «ne mérite pas de gérer les lieux saints» de l’islam, alors que le grand mufti de l’Arabie sunnite, Abdel Aziz ben al-Cheikh, a lancé que les Iraniens n’étaient «pas des musulmans». L’Arabie saoudite «ne pense même pas aux mesures de sécurité» pour le pèlerinage, a affirmé Saïd Ohadi, chef de l’organisation iranienne du hajj. Vendredi, des milliers d’Iraniens ont défilé à Téhéran sous des pancartes proclamant qu’ils ne «pardonneraient jamais» à l’Arabie saoudite leur exclusion du hajj".
En 2017, le pèlerinage s'est déroulé du 30 août au 4 septembre 2017.
Le 19 août 2018, plus de deux millions de musulmans, mais pas du Qatar, ont initié ce pèlerinage : "Les plus gros contingents de pèlerins viennent d'Égypte, d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh et du Soudan". "Le jeune prince héritier Mohammed Ben Salman, fils du roi et inspirateur des réformes, a clamé la volonté de son pays de «renouer avec un islam modéré et tolérant», tout en multipliant les arrestations dans les milieux dissidents, y compris parmi les défenseurs des droits de l'Homme et les religieux critiques. Le pèlerinage intervient en outre en pleine guerre au Yémen où l'Arabie saoudite intervient contre des rebelles soutenus par l'Iran, le grand rival régional de Riyad."
"Le siège de La Mecque"
 Arte diffusa le 21 août 2018 à 22 h 45 "Le siège de La Mecque" ("Mekka 1979 - Urknall des Terrors?", "The Siege of Mecca"), documentaire réalisé par Dirk van den Berg. "En 1979, le premier jour du hadj, un commando de 400 extrémistes religieux prend d’assaut la Grande Mosquée de La Mecque, retenant en otages des milliers de pèlerins. Pendant plus de deux semaines, ce siège ébranle l’Arabie Saoudite. Ce film dévoile l’un des secrets les mieux gardés de l’histoire contemporaine, événement fondateur du terrorisme fondamentaliste aussi méconnu que stupéfiant".
Arte diffusa le 21 août 2018 à 22 h 45 "Le siège de La Mecque" ("Mekka 1979 - Urknall des Terrors?", "The Siege of Mecca"), documentaire réalisé par Dirk van den Berg. "En 1979, le premier jour du hadj, un commando de 400 extrémistes religieux prend d’assaut la Grande Mosquée de La Mecque, retenant en otages des milliers de pèlerins. Pendant plus de deux semaines, ce siège ébranle l’Arabie Saoudite. Ce film dévoile l’un des secrets les mieux gardés de l’histoire contemporaine, événement fondateur du terrorisme fondamentaliste aussi méconnu que stupéfiant"."Avec certains de ses témoins clés, retour sur l'insurrection occultée qui a ciblé en 1979 la Grande Mosquée de La Mecque et sur sa répression sanglante, menée avec le soutien secret de la France. Dirk van den Berg livre un exceptionnel récit de l'intérieur, tirant un à un les fils historiques, politiques et géostratégiques de cet événement spectaculaire et oublié."
 "Le 20 novembre 1979, à l'aube, un commando de plusieurs centaines d'hommes lourdement armés, accompagnés de femmes et d'enfants, prend possession de la Grande Mosquée de La Mecque et transforme le sanctuaire le plus sacré de l'islam en une forteresse. À sa tête, un Saoudien, Juhayman al-Otaibi, prédicateur issu d'une tribu bédouine marginalisée, qui exige l'abdication de la famille royale, l'expulsion de tous les étrangers impies et le retour du pays à un islam pur. Des milliers de pèlerins prennent la fuite, mais plusieurs centaines d'autres sont piégés à l'intérieur, durant un siège qui va durer quinze jours. La famille régnante commence par imposer un secret absolu puis, la situation s'éternisant, en appelle à ses alliés occidentaux."
"Le 20 novembre 1979, à l'aube, un commando de plusieurs centaines d'hommes lourdement armés, accompagnés de femmes et d'enfants, prend possession de la Grande Mosquée de La Mecque et transforme le sanctuaire le plus sacré de l'islam en une forteresse. À sa tête, un Saoudien, Juhayman al-Otaibi, prédicateur issu d'une tribu bédouine marginalisée, qui exige l'abdication de la famille royale, l'expulsion de tous les étrangers impies et le retour du pays à un islam pur. Des milliers de pèlerins prennent la fuite, mais plusieurs centaines d'autres sont piégés à l'intérieur, durant un siège qui va durer quinze jours. La famille régnante commence par imposer un secret absolu puis, la situation s'éternisant, en appelle à ses alliés occidentaux." "C'est finalement le GIGN français qui aidera en secret l'armée saoudienne à combattre les insurgés, notamment en lui fournissant plus de 300 kilos de gaz lacrymogène. Au total, le bilan des combats au sein de la Grande Mosquée s'élèverait à des milliers de morts, même si le régime saoudien en reconnaît moins de trois cents. Après l'exécution sans procès des rebelles, il va s'efforcer de faire oublier au pays et au reste du monde cet épisode sanglant, tout en intensifiant la répression de toute forme d'opposition."
"C'est finalement le GIGN français qui aidera en secret l'armée saoudienne à combattre les insurgés, notamment en lui fournissant plus de 300 kilos de gaz lacrymogène. Au total, le bilan des combats au sein de la Grande Mosquée s'élèverait à des milliers de morts, même si le régime saoudien en reconnaît moins de trois cents. Après l'exécution sans procès des rebelles, il va s'efforcer de faire oublier au pays et au reste du monde cet épisode sanglant, tout en intensifiant la répression de toute forme d'opposition." "L'ex-chef des services secrets saoudiens Turki al-Fayçal, membre de la famille royale, le journaliste Khaled al-Maeena, le fils du général qui a dirigé l'assaut des forces saoudiennes (lequel offre au réalisateur les vidéos des combats qu'il cherchait depuis cinq ans), d'anciens frères d'armes de Juhayman, un très influent prédicateur djihadiste basé en Jordanie, Abou Mohammad al-Maqdisi, l'ancien attaché militaire américain à Djedda, Mark Hambley, les ex-GIGN Christian Prouteau et Paul Barril, les chercheurs Madawi al-Rasheed et Pascal Ménoret… : grâce à ces témoins et à leurs archives personnelles, Dirk van den Berg livre un exceptionnel récit de l'intérieur, tirant un à un les fils historiques, politiques et géostratégiques de cet événement spectaculaire et oublié. Il révèle ainsi un pan d'une réalité complexe, celle d'un pays fermé d'ordinaire aux regards extérieurs."
"L'ex-chef des services secrets saoudiens Turki al-Fayçal, membre de la famille royale, le journaliste Khaled al-Maeena, le fils du général qui a dirigé l'assaut des forces saoudiennes (lequel offre au réalisateur les vidéos des combats qu'il cherchait depuis cinq ans), d'anciens frères d'armes de Juhayman, un très influent prédicateur djihadiste basé en Jordanie, Abou Mohammad al-Maqdisi, l'ancien attaché militaire américain à Djedda, Mark Hambley, les ex-GIGN Christian Prouteau et Paul Barril, les chercheurs Madawi al-Rasheed et Pascal Ménoret… : grâce à ces témoins et à leurs archives personnelles, Dirk van den Berg livre un exceptionnel récit de l'intérieur, tirant un à un les fils historiques, politiques et géostratégiques de cet événement spectaculaire et oublié. Il révèle ainsi un pan d'une réalité complexe, celle d'un pays fermé d'ordinaire aux regards extérieurs."On ne comprend pas pourquoi le Conseil régional d'Ile-de-France a subventionné ce documentaire ainsi présenté : "Le 20 novembre 1979, lors du pèlerinage annuel du Hadj, des fondamentalistes saoudiens, dirigé par Juhayman Al-Utaiby, prennent d'assaut la Grande Mosquée de la Mecque, le lieu le plus saint de l'Islam. Ils demandent l'abdication de la famille royale saoudienne, l'expulsion des non-musulmans et le retour d'un Islam intransigeant wahhabite. Commence un siège de 18 jours qui fera près de 5000 morts. Le GIGN obtiendra finalement la réédition du commando. Cet événement est le premier acte d'un mouvement qui donnera naissance à Al Qaïda et Daesh". "Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants". Le montant de la subvention maximum s'élève à 53 000 €. Cela fait cher le coût du stagiaire ou de l'alternant.
Coronavirus
Le 29 juillet 2020 a débuté le pèlerinage à La Mecque dans le cadre de la pandémie de coronavirus. Au 9 juin 2020, "on recensait un total de 105 283 personnes infectées, 746 décès et 74 524 guérisons dans le royaume". Au 29 juillet 2020, le royaume "a enregistré environ 270 000 cas d'infection au nouveau coronavirus, soit l'un des taux les plus élevés du Moyen-Orient".
 "Au lieu de voir défiler 2,5 millions de fidèles, comme l’année dernière, la cité la plus sainte du monde musulman ne devrait accueillir que quelques milliers de croyants, 10 000 au maximum. Une affluence minimale, quasi-symbolique, qui constitue une première dans l’histoire du royaume saoudien, fondé en 1932.
"Au lieu de voir défiler 2,5 millions de fidèles, comme l’année dernière, la cité la plus sainte du monde musulman ne devrait accueillir que quelques milliers de croyants, 10 000 au maximum. Une affluence minimale, quasi-symbolique, qui constitue une première dans l’histoire du royaume saoudien, fondé en 1932. "Les autorités saoudiennes ont décidé de maintenir la fermeture de La Mecque aux pèlerins étrangers. Cette décision avait été prise fin février, à l’orée de la crise sanitaire. Alors même qu’aucun cas d’infection par le Covid-19 n’avait été enregistré dans le pays, Riyad avait suspendu la délivrance de visa pour l’omra, le petit pèlerinage, qui peut être effectué tout au long de l’année."
"Les autorités saoudiennes ont décidé de maintenir la fermeture de La Mecque aux pèlerins étrangers. Cette décision avait été prise fin février, à l’orée de la crise sanitaire. Alors même qu’aucun cas d’infection par le Covid-19 n’avait été enregistré dans le pays, Riyad avait suspendu la délivrance de visa pour l’omra, le petit pèlerinage, qui peut être effectué tout au long de l’année.""L’autorisation de participer au grand pèlerinage, qui se tient traditionnellement à l’approche de la fête de l’Aïd-el-Kébir, la plus importante date du calendrier musulman, n’a donc été délivrée qu’à une poignée d’habitants du royaume ; 30 % d’entre eux sont des Saoudiens, professionnels de la santé et membres de l’armée, qui ont attrapé le Covid-19 dans le cadre des efforts déployés par l’Etat pour lutter contre cette maladie, ont guéri et se voient ainsi récompensés pour leur dévouement. Les 70 % restant sont des résidents étrangers, choisis par tirage au sort."
"Le siège de La Mecque" documentaire réalisé par Dirk van den Berg.
Allemagne, France, Outremer Film, K2 Productions, INA, PROCIREP - Société des Producteurs, Conseil régional d'Ile-de-France, 2015, 52 min
Sur Arte le 21 août 2018 à 22 h 45
Visuels :
Visuels :
Vue aerienne de nuit de l'esplanade de La Mecque et de la Kabaa, Arabie Saoudite.
Vue aérienne de nuit de La Mecque (ville de l'ouest de l'Arabie Saoudite et capitale de la province de de la Mecque) et son horloge.
Soldats saoudiens catacombes
Deux Soldats saoudiens dans les catacombes de la mosquée
© K2-Outremerfilm
Du 23 avril au 17 août 2014Vue aérienne de nuit de La Mecque (ville de l'ouest de l'Arabie Saoudite et capitale de la province de de la Mecque) et son horloge.
Soldats saoudiens catacombes
Deux Soldats saoudiens dans les catacombes de la mosquée
© K2-Outremerfilm
A l’Institut du monde Arabe (IMA)
Niveaux 1 et 2
1, rue des Fossés-Saint-Bernard. Place Mohammed-V. 75005 Paris
Tél. : 01 40 51 38 38
Du mardi au jeudi de 9h30 à 19h, nocturne le vendredi jusqu'à 21h30, week-ends et jours fériés de 9h30 à 20h
Visuels :
Photographies du vernissage
© Présidence de la République
Pèlerins allant à La Mecque
Léon Belly 1861
© RMN-Grand Palais
(musée d’Orsay) / Franck Raux/Stephane Marechalle
Camps de pélerins turcs, Mirza,
Vers 1890
© King Abdulaziz Public Library
Vue de Jaba al-Rahma, 2000
© Reem Al Faisal
Articles sur ce blog concernant :
Les citations proviennent du dossiers de presse. Cet article a été publié les 17 août et 3 octobre 2014, 25 septembre 2015, 12 septembre 2016, 8 septembre 2017, 22 août 2018 et 30 juillet 2020. Il a été modifié le 30 juillet 2020.




%2B_%2BFranck%2BRaux%2B_%2BStephane%2BMarechalle.jpg)