Ossip Mandelstam (1891-1938) est un poète - Pierre (1912), Tristia (1922), Les Cahiers de Voronèj -, représentant de l’acméisme, et essayiste polyglotte russe. Son livre Épigramme contre Staline (1933) suscite l’ire de dirigeants l’Union soviétique. Ossip Mandelstam est arrêté, exilé, et décède lors de sa déportation vers la Kolyma au camp de transit de Vladperpunkt près de la gare de Vtoraïa Retchka à Vladivostok. Arte diffusera le 28 avril 2023 à 18 h 05 dans le cadre d’« Invitation au voyage », « Ossip Mandelstam, poète du crépuscule russe ».
« Les religions » par Sylvie Deraime
« Histoire du judaïsme » par Sonia Fellous
« Histoire de la Bible de Moïse Arragel - Quand un rabbin interprète la Bible pour les chrétiens (Tolède 1422-1433) » de Sonia Fellous
« Pourquoi on tue des chrétiens dans le monde aujourd'hui ? La nouvelle christianophobie » par Alexandre del Valle
Claude Lévi-Strauss (1908-2009)
Vladimir Jankélévitch (1903-1985)
Raymond Aron (1905-1983) « Histoire du judaïsme » par Sonia Fellous
« Histoire de la Bible de Moïse Arragel - Quand un rabbin interprète la Bible pour les chrétiens (Tolède 1422-1433) » de Sonia Fellous
« Pourquoi on tue des chrétiens dans le monde aujourd'hui ? La nouvelle christianophobie » par Alexandre del Valle
Claude Lévi-Strauss (1908-2009)
Vladimir Jankélévitch (1903-1985)
« ENS : L'école de l’engagement à Paris » par Antoine de Gaudemar et Mathilde Damoisel
Archives de la vie littéraire sous l'Occupation
« Blaise Cendrars - Comme un roman » par Jean-Michel Meurice
Pierre Clostermann (1921-2006)
« Ô vous, frères humains ». Luz dessine Albert Cohen
Pierre Clostermann (1921-2006)
« Ô vous, frères humains ». Luz dessine Albert Cohen
Edmond Fleg (1874-1963), chantre Juif et sioniste du judaïsme
« Gallimard, le Roi Lire » de William Karel
« Gallimard, le Roi Lire » de William Karel
Marilyn Monroe vue par Anne Gorouben et Olivier Steiner
« Du Panthéon à Buenos Aires » de René Goscinny
Les mondes de Gotlib
« Du Panthéon à Buenos Aires » de René Goscinny
Les mondes de Gotlib
« Stéphane Hessel - L´homme d´un siècle » par Hans Helmut Grotjahn et Antje Starost
« Histoire de l'islamisation française 1979-2019 »
« Histoire de l'islamisation française 1979-2019 »
Max Jacob (1876 -1944)
Jul, dessinateur et auteur de BD
Regards sur la littérature israélienne
« Ephraïm Kishon - Rire pour survivre » par Dominik Wessely
Jul, dessinateur et auteur de BD
Regards sur la littérature israélienne
« Ephraïm Kishon - Rire pour survivre » par Dominik Wessely
« La trahison des clercs d’Israël » par Pierre Lurçat
« Pour Allah jusqu’à la mort. Enquête sur les convertis à l’islam radical » par Paul Landau
« Israël, le rêve inachevé. Quel État pour le peuple juif ? » de Pierre Lurçat
« L’écrivain Ernst Jünger. Dans les tréfonds de l‘Histoire » par Falko Korth
Henry Lafont (1920-2011)
« Métamorphoses de Kafka » par Gérard-Georges Lemaire
« L’énigme du fils de Kafka » de Curt Leviant
« Pour Allah jusqu’à la mort. Enquête sur les convertis à l’islam radical » par Paul Landau
« Israël, le rêve inachevé. Quel État pour le peuple juif ? » de Pierre Lurçat
« L’écrivain Ernst Jünger. Dans les tréfonds de l‘Histoire » par Falko Korth
Henry Lafont (1920-2011)
« Métamorphoses de Kafka » par Gérard-Georges Lemaire
« L’énigme du fils de Kafka » de Curt Leviant
« La vie balagan de Marceline Loridan-Ivens » par Yves Jeuland
« Ô vous, frères humains ». Luz dessine Albert Cohen
« Ô vous, frères humains ». Luz dessine Albert Cohen
Pierre Mendès France (1907-1982)
« Mermoz » par Catherine Herszberg et Anne Proenza
Arthur Miller (1915-2005)
Rutu Modan
« Mermoz » par Catherine Herszberg et Anne Proenza
Arthur Miller (1915-2005)
Rutu Modan
George Orwell (1903-1950)
David Perlov. Cinéaste, photographe, dessinateur
« Pif, l’envers du gadget » par Guillaume Podrovnik
David Perlov. Cinéaste, photographe, dessinateur
« Pif, l’envers du gadget » par Guillaume Podrovnik
Mordecai Richler (1931-2001)
« Bons baisers de la planète Schtroumpf » par Jean-Marc Panis
Hugo Pratt (1927-1995)
« Bons baisers de la planète Schtroumpf » par Jean-Marc Panis
Hugo Pratt (1927-1995)
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
« L'enfant, la mort et la vérité », de Esther Schapira et Georg M. Hafner
« L'enfant, la mort et la vérité », de Esther Schapira et Georg M. Hafner
« Les Amnésiques » par Géraldine Schwarz
Joann Sfar, dessinateur et réalisateur
« Art Spiegelman, traits de mémoire » de Clara Kuperberg et Joëlle Oostelinck
« Riad Sattouf. L’écriture dessinée »
Joann Sfar, dessinateur et réalisateur
« Art Spiegelman, traits de mémoire » de Clara Kuperberg et Joëlle Oostelinck
« Riad Sattouf. L’écriture dessinée »
Ossip Mandelstam (1891-1938) est né dans une famille juive bourgeoise à Varsovie, alors dans l'empire russe.
Il étudie à Saint-Pétersbourg, à l'école Tenichev (1900-1907), puis à la Sorbonne à Paris (octobre 1907-mai 1908) où il a pour professeurs Joseph Bédier et Henri Bergson et apprécie le poète Verlaine. Interdit d'accès à l'université de Saint-Pétersbourg par des quotas d'étudiants juifs, il se rend en septembre 1909 dans l'empire allemand. Jusqu'en 1910, il suit des cours de littérature française ancienne et l'histoire de l'art à l’université de Heidelberg.
Il se fait baptiser selon le rite méthodiste-épiscopal, peu important en Russie tsariste, en 1911 pour étudier, jusqu'en 1917, la philosophie à l’université de Saint-Pétersbourg.
Dès 1911, Ossip Mandelstam adhère à la Guilde des poètes : la revue Apollon publie ses premiers poèmes.
De janvier à juin 1916, il vit une histoire d'amour avec Marina Tsvetaïeva.
Il fait la connaissance de Boris Pasternak.
Hostile au symbolisme russe, il représente l'école acméiste, définie comme « la nostalgie de la culture universelle », créée par Nikolaï Goumilev et Sergueï Gorodetski et qui réunit aussi Anna Akhmatova et Mikhaïl Kouzmine. Il conçoit ses poèmes comme une architecture dont « les mots sont des pierres, "voix de la matière" autant que matière de la voix ».
Citons ses trois recueils : Pierre (en russe « Камень », Kamen), qui le rend célèbre en 1912, Tristia (1922), qui le consacre, Les Cahiers de Voronèj, écrits entre 1935 et 1937, durant son exil.
Dans La Quatrième prose, Ossip Mandelstam répond à l'accusation, notamment par Arkadi Gornfeld, de plagiat qu'il subit et désigne le groupe littéraire stalinien.
Dans les années 1920, il gagne sa vie comme auteur de livres pour enfants et traducteur des œuvres d'Upton Sinclair, de Jules Romains, de Charles De Coster.
Ossip Mandelstam se perçoit comme un marginal dont la destinée présenterait des points communs avec celle de Pouchkine. Il se soucie de la pérennité de la culture russe menacée par le bolchevisme. Ce qui nourrit des soupçons d'« activité contre-révolutionnaire ».
En 1930, Mandelstam se rend en Arménie avec son épouse Nadejda. Il y écrit Voyage en Arménie. Il se lie d'amitié avec l'entomologiste et poète Boris Kouzine. s'intéresse à la théorie de l'évolution et aux formes évolutives de la nature. Il avait écrit « l'étude de la poésie ne deviendrait une science que lorsqu'on y appliquerait les méthodes de la biologie »
De retour en Union soviétique, il retourne à l'expression poétique. À l'automne 1933, il écrit un poème satirique de seize vers, Epigramme contre Staline, Le Montagnard du Kremlin.
Dans la nuit du 16 au 17 mai 1934, trois agents de la Guépéou arrêtent à son domicile Mandelstam, effectuent une perquisition sur le fondement du mandat d’arrêt signé de Guenrikh Iagoda. A 7 heures du matin, Mandelstam est amené à la Loubianka. Tous ses manuscrits, lettres, carnet d’adresses, sont pris.
En dépit d'interventions de ses proches et d'intellectuels, le 26 mai 1934 est annoncée la condamnation à trois ans de relégation à Tcherdyne, dans la région de Perm (Oural). Son épouse est autorisée à l'accompagner. Après une tentative de suicide dans la nuit du 3 au 4 juin 1934, le verdict est modifié : le quadragénaire Mandelstam aura la faculté de choisir son lieu de relégation, sauf douze villes de l’URSS. Sa santé se fragilise.
Ossip Mandelstam retient la ville de Voronej, « dans la région des Terres noires, en Russie centrale, à six cents kilomètres au sud de Moscou ». Vers le 25 juin 1934, le couple Mandelstam arrive dans cette région où la vie est difficile pour le couple (La mendiante). Mandelstam écrit les Cahiers de Voronej, « des poèmes d’une beauté et d’une forces indicibles » selon Anna Akhmatova (Feuillet du Journal, 1957)
Ossip Mandelstam y meurt à quarante-sept ans – « Ma santé est très mauvaise. Je suis maigre et complètement épuisé, presque méconnaissable, je ne sais si cela vaut la peine d’envoyer des vêtements et de l’argent » – le 27 décembre 1938, lors d’une séance de traitement de poux par grand froid, chez les zeks. Il est enterré dans une fosse commune.
Nadejda Mandelstam a relaté les difficultés pour avoir des informations sur le décès de son époux dans ses mémoires Contre tout espoir. Souvenirs.
La réhabilitation de cet auteur a débuté en 1956, durant le « dégel » de la déstalinisation : il a été disculpé des accusations remontant en 1938. Le 28 octobre 1987, sous le gouvernement de Mikhaïl Gorbatchev, Ossip Mandelstam est entièrement lavé des accusations de 1934.
En 1977, une petite planète découverte par l'astronome soviétique Nikolaï Stepanovitch Tchernykh est dénommée Mandelstam.
La renommée du poète croit dans les années 1970, avec la publication de ses œuvres en Occident et en Union soviétique.
L'œuvre de Mandelstam a influencé de nombreux poètes, parmi lesquels Paul Celan qui lui dédie son recueil La Rose de personne, André du Bouchet ou Philippe Jaccottet, Serge Venturini.
« Ossip Mandelstam, poète du crépuscule russe »
« Invitation au voyage » est « le magazine de l'évasion culturelle ». « Du lundi au vendredi à 18h10, Linda Lorin nous entraîne autour du monde à la découverte de lieux qui ont inspiré des artistes, de cités et de cultures uniques et nous invite dans les cuisines et les restaurants du monde entier. Le samedi à 16h35, "Invitation au voyage spécial" propose une escapade à la découverte d'une ville, d'une région ou d'un pays. »
Arte diffusera le 28 avril 2023 à 18 h 05 dans le cadre d’« Invitation au voyage », « Ossip Mandelstam, poète du crépuscule russe ».
« Au tournant du XXe siècle, l’architecture fastueuse de Saint-Pétersbourg frappe l’imaginaire du poète Ossip Mandelstam alors qu’il est encore enfant. »
« Lorsque la révolution bolchévique s’abat sur la ville, elle perd sa quintessence aux yeux du poète. À travers ses recueils La Pierre et Tristia, il retranscrit cette transformation à la fois brutale et tragique durant la montée du communisme. »
France, 2022, 14 min
Sur Arte le 28 avril 2023 à 18 h 05
Disponible du 22/04/2022 au 22/04/2024
Les citations sont d'Arte.













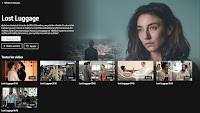



.jpg)





.jpg)








