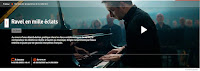Maurice Ravel (1875-1937) était un compositeur français majeur, avec Claude Debussy (1862-1918), de la musique française au début du XXe siècle. Il a abordé des genres variés : ballet symphonique Daphnis et Chloé (1909-1912), Boléro (1928), deux concertos pour piano et orchestre pour la main gauche (1929-1930) et en sol majeur (1929-1931), opéras - L'Heure espagnole, L'Enfant et les sortilèges -, orchestration des Tableaux d'une exposition de Moussorgski (1922). Ses œuvres - quatre-vingt-six œuvres originales (Pavane pour une Infante défunte), vingt-cinq œuvres orchestrées ou transcrites - ont été influencées par Couperin, Rameau, l’Espagne et le jazz. A l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Maurice Ravel, Arte propose un documentaire et des concerts.
Paul Dessau (1894-1979)
Saleem Ashkar
Daniel Barenboim
Le camp de Theresienstadt ou Terezín
« L’Empereur de l’Atlantide », de Viktor Ullmann et Peter Kien
« Plus jamais les camps ! L'autre message de l'opéra Brundibar » (Wiedersehen mit Brundibar) de Douglas Wolfsperger
Frédéric Chopin, la Note bleue
« L’Empereur de l’Atlantide », de Viktor Ullmann et Peter Kien
« Plus jamais les camps ! L'autre message de l'opéra Brundibar » (Wiedersehen mit Brundibar) de Douglas Wolfsperger
Frédéric Chopin, la Note bleue
« Un virtuose sans égal. Le violoniste Jascha Heifetz » par Peter Rosen
« Hello I am David. Un voyage avec David Helfgott » par Cosima Lange
Herbert von Karajan (1908-1989)
« Hello I am David. Un voyage avec David Helfgott » par Cosima Lange
Herbert von Karajan (1908-1989)
Yehudi Menuhin (1916-1999), violoniste et chef d’orchestre
Ennio Morricone (1928-2020)
Jacques Offenbach (1819-1880)
Murray Perahia, pianiste et chef d’orchestre
Itzhak Perlman
Ennio Morricone (1928-2020)
Jacques Offenbach (1819-1880)
Murray Perahia, pianiste et chef d’orchestre
Itzhak Perlman
« Arthur Rubinstein » de Marie-Claire Margossian et « Arthur Rubinstein interprète Chopin, Concerto pour piano n° 2 »
« Sur la route de Jérusalem avec Jordi Savall. La ville des deux paix » par Michael Beyer
Arnold Schönberg. Peindre l'âme
Martial Solal, pianiste de jazz
« Requiem pour la vie », de Doug Schulz« Sur la route de Jérusalem avec Jordi Savall. La ville des deux paix » par Michael Beyer
Arnold Schönberg. Peindre l'âme
Martial Solal, pianiste de jazz
Maurice Ravel (1875-1937) était un compositeur français exigeant, majeur, avec Claude Debussy (1862-1918), de la musique française au début du XXe siècle. Malgré cinq échecs au Prix de Rome.
Marqué par la Grande guerre, il a abordé des genres variés : ballet symphonique Daphnis et Chloé (1909-1912), Boléro (1928), deux concertos pour piano et orchestre pour la main gauche (1929-1930) et en sol majeur (1929-1931), opéras - L'Heure espagnole, L'Enfant et les sortilèges -, orchestration des Tableaux d'une exposition de Moussorgski (1922). Ses œuvres - quatre-vingt-six œuvres originales (Pavane pour une Infante défunte), vingt-cinq œuvres orchestrées ou transcrites - ont été influencées par Couperin, Rameau, l’Espagne et le jazz. »
Manuel Rosenthal a été un de ses élèves, puis un ami de Maurice Ravel. Il lui a consacré une biographie.
« Les obsèques – très simples – eurent lieu le 30 décembre devant Edouard Ravel et une large foule d’amis et de collègues dont Georges Auric, Jane Bathori, Robert Casadesus, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Igor Stravinsky et Ricardo Vines. Au cours d’une brève cérémonie officielle, Jean Zay, ministre de l’Education nationale, prononça l’éloge funèbre au nom du gouvernement. » (Maurice Ravel, Lettres, écrits et entretiens, présentés et annotés par Arbie Orenstein, Flammarion 1989).
Jean Zay, ministre de l’Education Nationale et des Beaux-Arts du Front populaire, a alors prononcé un discours hommage au défunt :
« C’est sous le signe de l’intelligence que s’est déroulée la carrière de cet homme exquis, dont le regard, le sourire, tout l’être nerveux et précis révélaient qu’il était aimé de la vie et favorisé de grâces particulières...Dans tous ces ouvrages, infiniment divers, s’exerce la séduction d’un esprit toujours inquiet de se laisser surprendre et duper par quoi que ce soit qui ne serait pas la musique. Aussi se prouve-t-il constamment à lui-même qu’il reste maître de ses moyens. Et cette puissance lucide et allègre nous procure un spectacle prodigieusement réconfortant. Car Ravel possède une arme qui est l’ironie, c’est-à-dire l’intelligence se connaissant elle-même et jouissant d’elle-même en même temps qu’elle se domine. Tout ce qu’elle peut faire, elle le tente. Et ce qu’elle ne peut faire, elle y renonce, non point parce que ce n’est pas possible, mais parce que ce ne serait pas humain. Et en ceci je veux voir le trait le plus profond du génie français...Si je considère le message de Ravel, si j’évoque les plus grands noms de notre tradition morale et artistique, Descartes et Le Nôtre, Racine et Voltaire, Marivaux et Stendhal, si je remémore cette rétrospective de l’art français que nous parcourions cet été et où se rejoignaient Fouquet, Watteau, Ingres et Cézanne, j’en arrive à me demander ce qui fait le caractère commun de tous ces génies et qui était l’essentiel du génie de Ravel, et je crois découvrir que c’est une même façon suprêmement intelligente de considérer les choses, fût-ce les choses les plus passionnées et les plus pathétiques, et de les soumettre à la règle d’un style. Aucune des puissances du cœur n’est absente de l’univers français. Et si elles se soumettent, c’est sans s’abaisser. Mais elles se soumettent. Et ce qui agit ainsi sur elles, ce n’est jamais, comme on pourrait le croire, une force plus vigoureuse et qui se manifesterait sous un aspect fatal et titanique, mais un charme seulement comparable aux choses les plus légères, non pas au souffle des tempêtes, mais à la brise fugitive qui passe sans s’appesantir ni tourner la tête. »
Les droits d'auteur de Maurice Ravel ont été alloués à Edouard Ravel, son frère. Au décès de ce dernier, c'est le couple Taverne, qui veillait sur lui, qui en hérite. En 1969, Jean-Jacques Lemoine, soixantenaire, démissionne de sa fonction de directeur juridique de la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), et devient avocat. Le 17 novembre 1941, il avait signé pour cet organisme l'acte de spoliation des droits d'auteurs « juifs ». Il devient conseiller juridique d'Alexandre Taverne. Tous deux obtiennent, au terme de procès contre René Dommange, patron octogénaire des éditions Durand, propriétaire des contrats d'édition de Ravel, une modification de ces contrats jusque-là très favorables à l'éditeur. Jean-Jacques Lemoine effectue des montages juridico-financiers dans le cadre de l'optimisation fiscale en créant des sociétés-écrans enregistrées hors de l'hexagone, dans des paradis fiscaux, en toute opacité.
« Kaddish »
Dans la liturgie juive, le kaddish ("sanctification") est une prière en araméen, associant bénédictions, louanges et glorifications de D. et s'achève par un espoir de paix dans le monde. Après la destruction du Temple de Jérusalem, le peuple Juif exilé le récitait pour exprimer leur espoir en Dieu. Dans le judaïsme orthodoxe, elle est conditionnée par un quorum : dix hommes ayant la majorité religieuse (soit 13 ans, âge de la bar mitzva). Elle est dite à plusieurs reprises durant l'office de chabbat et par les fidèles juifs en deuil, bien que le texte n'évoque pas la mort.
A la demande d'Alvina Alvi, soprano de l'Opéra de Saint-Pétersbourg (Empire russe), Maurice Ravel a composé, en s'inspirant de chants traditionnels, les Deux Mélodies hébraïques pour voix et piano en 1914 : Kaddisch, est une oeuvre en langue araméenne, L'Enigme éternelle, plus brève, est en langue yiddish.
Sur France Inter, Frédéric Pommier, journaliste, a rappelé qu'Alvina Alvi et Maurice Ravel s'étaient rencontrés à Londres (Royaume Uni) en 1909. La soprano lui avait commandé un diptyque qui "refléterait deux faces de la culture juive". Le 3 juin 1914, lors d'un concert de la soprano accompagnée au piano par ce compositeur, a été créée cette pièce piano/voix. Dès 1920, une version orchestrale est conçue, et est suivie de nombreux arrangements. A ceux le croyant à tort juif, Maurice Ravel a déclaré en 1928 : « Je ne suis pas Juif. J’ajoute que si je l’étais, je ne m’en cacherais nullement ».
Kaddisch est interprété notamment lors de cérémonies à la mémoire de victimes des nazis, ainsi en 2022, cette oeuvre a été interprétée par la cantatrice Barbara Hendrix au camp des Mille.
Le 7 février 2024, à l'Hôtel national des Invalides, a eu lieu la cérémonie hommage aux victimes de l'agression djihadiste du 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël, en présence de représentants des familles, de dirigeants communautaires et d'élus. Elle était présidée par le Chef de l'Etat, Emmanuel Macron. Le Kaddish de Maurice Ravel a été interprété par un pianiste et un violoniste de la Garde républicaine.
« Ravel Boléro »
En 2025, la Philharmonie de Paris a proposé l'exposition « Ravel Boléro ». Le commissaire de l'exposition était Pierre Korzilius, et la conseillère musicale Lucie Kayas. « Le Boléro incarne presque toutes les caractéristiques de la production et de la personnalité de Ravel. Sous la forme d’une exposition dédiée à l’étude rayonnante de cette œuvre, la Philharmonie de Paris célèbre le 150e anniversaire de la naissance du compositeur et livre un portrait de l’artiste en forme de kaléidoscope. Le parcours propose une expérience audiovisuelle saisissante, en même temps qu’il réunit des objets patrimoniaux issus des collections françaises les plus prestigieuses, notamment de la maison-musée Ravel à Montfort-l’Amaury, où fut composé le Boléro. »
HYMNE A LA DANSE
« Monument de l’histoire de la musique, le Boléro est une composition paradoxale, tant pour Ravel que pour le public. « Mon chef-d’œuvre ? Le Boléro, bien sûr ! Malheureusement, il est vide de musique », écrivait le musicien en 1928. Cette remarque à la fois provocante et espiègle masque un coup de génie : avec une économie extrême de moyens, un ostinato rythmique, deux motifs mélodiques, un crescendo orchestral et une modulation inattendue, Ravel crée un chef-d’œuvre universel, fruit d’une réflexion musicale radicale. Commande de la danseuse et chorégraphe Ida Rubinstein, le Boléro est d’abord pensé pour la danse. Son rythme hypnotique évoquant les castagnettes saisit l’auditeur dès les premières secondes pour ne plus le lâcher. Maquettes de décors et dessins de costumes font revivre différentes productions du Boléro tout en évoquant d’autres partitions chorégraphiques de Ravel : Pavane pour une infante défunte, Daphnis et Chloé, La Valse. »
MUSIQUE EN IMAGES
« Le visiteur éprouve dès la première salle l’expérience physique de ce crescendo orchestral envoûtant, grâce à un dispositif cinématographique unique dédié à l’interprétation du Boléro par l’Orchestre de Paris et son directeur musical Klaus Mäkelä. Plus loin, les multiples réinterprétations musicales et chorégraphiques de l’œuvre – dont celles de Maurice Béjart, d’Aurél Milloss ou de Thierry Malandain – se déploient en une partition audiovisuelle qui montre que, depuis 1928, le Boléro n’a cessé de fasciner les interprètes. »
L'ESPAGNE REVISITEE
« Le Boléro – d’abord intitulé Fandango – s’inscrit dans toute une lignée d’œuvres ravéliennes inspirées par l’Espagne, de la Habanera de sa jeunesse à sa toute dernière pièce, Don Quichotte à Dulcinée, en passant par l’opéra L’Heure espagnole. Né à Ciboure, près de Saint-Jean-de-Luz, Ravel hérite de sa mère le goût de la musique espagnole et s’empare d’un imaginaire fait de sensualité et de rêve qu’il partage avec ses contemporains musiciens. Plusieurs œuvres d’art, comme Lola de Valence de Manet, apportent un écho pictural à ce goût pour une Espagne haute en couleur. »
UNE MECANIQUE DE PRECISION
« À la manière d’un enfant, Ravel se passionne pour toutes sortes de mécanismes, comme ceux des jouets et casse-têtes qui peuplent sa maison du Belvédère à Montfort-l’Amaury. Dans une lettre de 1928, le compositeur parle du Boléro comme d’une « machine ». Fils d’un ingénieur-inventeur, soucieux du moindre détail d’écriture et d’orchestration, Ravel excelle dans la production d’œuvres ciselées au mécanisme à la fois implacable et subtil, comme le Boléro. Il partage cette fascination avec de nombreux artistes de son temps, comme František Kupka ou Fernand Léger. »
« Maurice Ravel (1875-1937). 150 ans de génie musical »
« À l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Maurice Ravel , né le 7 mars 1875, ARTE vous invite à explorer l’univers fascinant et audacieux du compositeur français aux multiples inspirations. »
« De la virtuosité de son “Concerto pour la main gauche” au rythme envoûtant de son “Boléro”, Ravel a redéfini les frontières de la musique classique, alliant traditions et modernité visionnaire. »
« Partenaire de l’exposition "Ravel Boléro" à la Philharmonie de Paris, ARTE célèbre le 150e anniversaire de la naissance du compositeur à travers une riche offre de concerts et de documentaires. »
« Ravel en mille éclats »
Arte diffuse sur son site Internet « Ravel en mille éclats » de François-René Martin et Gordon.
« Au cours d’une déambulation poétique dans les lieux emblématiques de la vie de Maurice Ravel (1875-1937), le compositeur du "Boléro" se révèle à travers sa musique, dirigée notamment par Klaus Mäkelä et jouée par de grands interprètes français. »
« Qui était Maurice Ravel, que l’on décrivait comme un dandy timide et élégant, consciencieux et solitaire dont on célèbre en 2025 le 150e anniversaire de la naissance ? Né en 1875 et mort en 1937, le compositeur "répugnait à parler de lui-même", écrivait le musicologue Roland-Manuel en introduction de l’Esquisse autobiographique que le compositeur accepta de lui dicter en 1928, faute de consentir à un entretien. Outre ce court document, qui illustre avant tout la discrétion dont il fit preuve tout au long de sa vie, le père du Boléro a laissé pour seuls témoignages les quelques écrits, photos et courts films où il apparaît. »
« Le duo de réalisateurs François-René Martin et Gordon a imaginé une évocation purement musicale du père du Boléro. Protagonistes sans paroles, l’Orchestre de Paris et le maestro Klaus Mäkelä, le pianiste Bertrand Chamayou, la soprano colorature Sabine Devieilhe, le quatuor Modigliani, le chœur Accentus et sa cheffe Laurence Equilbey, la soprano Marie-Laure Garnier, la violoniste Raphaëlle Moreau et la pianiste Célia Oneto Bensaid s’emparent de ses chefs-d’œuvre mais aussi de pièces moins connues. »
« À chacun des chapitres du film, une partition jouée témoigne d'un aspect particulier de sa vie et de sa personnalité. »
« Tourné dans la maison-musée de Montfort-l'Amaury (où Ravel vécut jusqu’à sa mort), à l’église de Ciboure (où il fut baptisé), au couvent Sainte-Marie de la Tourette, construit par Le Corbusier à Évreux, et à la Philharmonie de Paris, ce film ancre chaque œuvre dans un univers esthétique riche en jeux de lumières et de couleurs, singulier palimpseste où se superposent des images du passé et du présent. »
« Chapitres
0:23
Ma mère l'Oye : V. Le Jardin féerique
4:30
Pavane pour une infante défunte
8:19
Vocalise-étude en forme de habanera
11:44
Quatuor en fa majeur : II. Assez vif. Très rythmé
18:38
Miroirs : II. Oiseaux tristes
22:57
Trois chansons : II. Trois beaux oiseaux du paradis
26:14
La Valse
39:28
Deux mélodies hébraïques : I. Kaddish
45:15
Blues de Sonate pour violon et piano : II. Blues
50:52
Boléro
1:07:00
Concerto en sol majeur : II. Adagio assai
1:16:27
Gaspard de la nuit : I. Ondine »
Sélection officielle, Fipadoc 2025
« Peu enclin aux confidences, Ravel s’est livré à travers sa musique. Des œuvres de jeunesse aux ultimes partitions, quatre morceaux, joués dans ce portrait musical, révèlent des facettes de cet être insaisissable. Par Roxane Borde.
1904
“Quatuor à cordes en ‘fa’ majeur”
"À mon cher maître Gabriel Fauré" : encore étudiant, Maurice Ravel dédie sa première pièce de musique de chambre au compositeur, qui est aussi son professeur au Conservatoire de Paris. Peu préoccupé par la réussite académique – il ne recevra aucune distinction ni en piano, ni en harmonie, ni en composition durant tout son cursus –, l’élève ne manque pas d’audace, et n’hésite pas à affronter, à 27 ans, l’effectif si exigeant du quatuor à cordes. Mais à la veille de la création, les doutes l’assaillent, et il songe à faire jouer moins fort cette œuvre majeure qui annonce déjà l’esthétique de l’entre-deux-guerres. "Au nom des dieux de la musique et au mien, ne touchez à rien de votre quatuor !”, l’exhorte son aîné Claude Debussy.
1920
“La valse”
S’il envisage dès 1906 d’écrire une "apothéose de la valse" en hommage à Johann Strauss, Ravel ne pourra s’y atteler qu’à l’issue de la Première Guerre mondiale. Déclaré inapte lorsqu’elle éclate en raison de sa petite taille et de sa stature frêle, il souhaite rejoindre son frère Édouard et parvient à se faire enrôler dans la section des transports. "Je suis pacifique, je n’ai jamais été courageux. Mais voilà : j’ai eu la curiosité de l’aventure !", expliquera-t-il avec la même ironie dont il dotera sa Valse après l’armistice, l’envisageant désormais comme un "tournoiement fantastique et fatal", symbole de la folie destructrice des hommes.
1928
“Le boléro”
Lorsque son amie et mécène Ida Rubinstein lui commande un ballet à caractère espagnol, Ravel, enfant du Pays basque fasciné par la danse et les territoires d’outre-Pyrénées, se sent chez lui. Si bien… qu’il tarde à s’y mettre. Il ira donc au plus efficace, imaginant une œuvre expérimentale à l’écriture simple et directe : un immense crescendo porté par un thème unique et un motif rythmique entêtant, qui rappelle la mécanique des jouets et casse-têtes dont il raffole. "Mon chef-d’œuvre ? Le boléro, bien sûr ! Malheureusement, il est vide de musique", dira-t-il ensuite avec espièglerie, s’amusant de la farce qu’il a faite au monde entier.
1932
“Le concerto en ‘sol’”
Après une tournée triomphale aux États-Unis, où il goûte aux plaisirs du blues et du jazz, Ravel finit par s’atteler au genre du concerto pour piano, infusant sa partition des rythmes et sonorités découverts au cours de son voyage. Dotée d'une forme plus traditionnelle que Concerto pour la main gauche qu’il compose en même temps, la pièce est virtuose, et le compositeur ne peut finalement pas la jouer lui-même lors de sa création : atteint d’une maladie du cerveau qui l’empêchera bientôt de parler et de bouger, il vient d’écrire sa dernière œuvre d’envergure, saisissante explosion de musique avant le silence. »
« Ravel en mille éclats » de François-René Martin et Gordon
France, 2023, 78 min
Coproduction : ARTE France, Camera Lucida, Cité de la musique – Philharmonie de Paris, Orchestre de Paris
Avec
Marie-Laure Garnier (Soprano)
Sabine Devieilhe (Soprano)
Bertrand Chamayou (Piano)
Célia Oneteo Bensaid (Piano)
Raphaëlle Moreau (Violon)
Direction musicale : Klaus Mäkelä
Orchestre : Orchestre de Paris
Quatuor Modigliani
Direction de chœur : Laurence Equilbey
Chœur : Accentus
Sur arte.tv du 23/02/2025 au 31/03/2026
Visuel : © Camera Lucida
A lire sur ce blog :